Sarah Roques TP n°2 : LA CHROMATOGRAPHIE
Objectifs :
·
Découvrir
une méthode pour séparer et identifier les espèces chimiques présentes dans un
mélange.
·
Réaliser
une chromatographie sur couche mince (C.C.M).
·
Utiliser
un vocabulaire adapté
Matériels
et réactifs disponibles :
- Colorants
alimentaires, eau salée.
- Papier pour
chromatographie, cuves à chromatographie, bâtonnets.
I. CHROMATOGRAPHIES DE
COLORANTS ALIMENTAIRES :
1)
Réalisation
du chromatogramme :
On
dispose de colorants ou mélange de colorants alimentaires : colorant vert
(noté V), jaune (J), rouge (R) et inconnu (X).
PROTOCOLE :
REMARQUES IMPORTANTES :
Prendre soin de respecter les consignes de suivantes :
·
La
cuve avec l’eau salée ne doit pas être déplacée au cours de l’expérience
·
Au
départ, la ligne de dépôt ne doit pas être au contact avec la solution eau
salée.
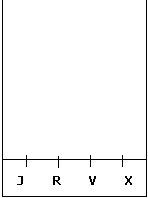
a)
Verser
environ
b)
Tracer
à
c)
A
l’aide de quatre différents bâtonnets, déposer une goutte des colorants
sur les emplacements prévus.
d)
Faire
vérifier le dispositif (commencer à répondre aux questions ci-dessous
pendant ce temps). Placer alors le papier pour chromatographie
verticalement en le maintenant à l’aide d’un pic puis refermer
e)
Attendre
quelques minutes et retirer le papier lorsque l’eau salée arrive à environ
f)
Tracer
alors, au crayon, une ligne horizontale indiquant la hauteur atteinte par l’eau
salée ; cette ligne s’appelle ligne de front.
2)
Travail
à faire :
a)
Faire
un schéma du dispositif au tout début de l’expérience.
b)
Comment
peut-on respectivement appeler l’eau salée et le papier pour
chromatographie ?
c)
Comment
s’appelle le moment où les espèces chimiques se déplacent par capillarité sur
le papier filtre ?
d)
Pourquoi
certains colorants migrent-ils plus vite que d’autres ? En déduire quelle
est l’« espèce » la plus soluble avec l’eau salée et celle qui l’est
le moins.
e)
Représenter
le chromatogramme obtenu à la fin de l’expérience.
f)
Mesurer
les rapports frontaux des colorants rouge (Rf (R)) et jaune (Rf
(J)).
g)
Quels
colorants correspondent à une seule espèce chimique ? Justifier. Quels
colorants correspondent à des mélanges d’espèces chimiques ? Justifier.
h)
Comparer
la distance parcourue par l’ « espèce » jaune lorsqu’elle est pure et
lorsqu’elle appartient à un mélange.
i)
Quelles
conclusions peut-on faire sur le « colorant » inconnu X ?
Justifier.
II. EXERCICES
D’APPLICATION :
Exercice
1 :
On a réalisé la chromatographie
de deux échantillons A et B ainsi que d'une espèce chimique
·
Front
de l’éluant :
·
Rapport
frontal de la menthone: Rf
(M) = 0,75.
·
Echantillon
A: on observe deux taches
situées à
·
Echantillon
B : on observe une seule
tache située à
a)
Déterminer
la hauteur de migration de la menthone.
b)
Représenter
le chromatogramme à l’échelle 1/1.
c)
Que
peut-on dire des échantillons A et B ?
Exercice 2 :
La recherche par chromatographie de certains acides dans le vin permet
de savoir si la transformation de l’acide malique en acide lactique
(fermentation malo-lactique) a eu lieu. Sur une plaque à chromatographie ont
été effectués les dépôts suivants : 1 = acide malique ; 2 = acide
lactique ; 3 = vin.
Remarque : on précise que les acides malique et lactique sont des
espèces chimiques incolores.
La plaque a été plongée dans un solvant à base de
butanol puis retirée. On l’a ensuite pulvérisée avec une solution de vert de
bromocrésol.
On a ainsi obtenu le chromatogramme suivant :
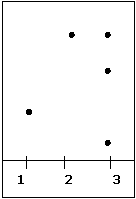
a)
Quel
est le rôle :
- de la solution de
butanol ?
- de la solution de
vert de bromocrésol ?
b)
Le
vin étudié contient-il :
- de l’acide
malique ? Justifier.
- de l’acide
lactique ? Justifier.
c)
La
transformation malo-lactique a-t-elle eu lieu ?
d)
Pourquoi
observe-t-on d’autres taches que celle de l’acide malique ou de l’acide
lactique ?